Il y aurait une histoire comorienne, non écrite, du renoncement aux valeurs d’un pays. Elle se confondrait avec des notions de lâcheté ou de mépris de soi. Elle permettrait de comprendre en tous cas comment on peut tourner le dos à son propre reflet dans le miroir. Elle est surtout synonyme de peur. Une peur pathologique, souvent incompréhensible, pour quiconque nie la réalité coloniale du destin commun. Cette contribution est initialement parue dans le n°5 du journal Uropve en novembre 2016.
La colonisation est finie. C’est un mot, un concept, une marque de fabrique. Il peut disparaître du dictionnaire, lorsque celui qui l’impose, décide de le remplacer par une nouvelle appellation. Simple jeu de langage, qui n’efface pas ce qui est. A savoir que nous sommes encore sous tutelle. Le dire revient d’ailleurs à reconnaître ce que l’on est, véritablement : des dominés en quête de leur liberté. L’indépendance, la fable, le déni, sont de vieilles antiennes qui fondent le principe d’évitement, nécessaire pour se mentir à soi-même. Elles nous préservent du trop plein de sincérité, qui remonte les amertumes en surface. D’où le reflet dans le miroir. Qui sait où cela pourrait se finir ? Dans l’indignation ? Un mot qu’on ne prononce plus dans des cercles de pouvoir, où la complexité consiste à confondre une puissance qui vous brise les reins avec une amitié de toujours. La France n’est pas notre amie. Car un ami ne vous effraie pas dans votre sommeil. Or, la France, sur nos terres, continue à faire peur.
Longtemps, cette France a porté le costume d’un maître sans compassions, venu se servir de ce qui appartient à autrui. Elle a alors développé tout un arsenal : conquête, protectorat, exploitation, puis partenariat. Nous n’avons jamais pu prendre le temps de réfléchir sur ces formes de co existence imposée. La tête dans le guidon nous éviterait de sombrer dans le questionnement de nos propres manquements. La tâche assignée par le maître absorbe tellement notre énergie que nous n’avons pas le temps de chercher à comprendre ce qui l’oblige à rester parmi nous[1]. Quelqu’un aurait un jour dit uka hazi ya mzungu ke hisa, badi neka hudumiziwa[2]. Un projet en soi, qui suppose le renvoi de la bête soumise, une fois qu’elle cesse d’être rentable ou profitable. Une loi ultra libérale de premier ordre, rendu encore plus violente, plus perverse, sous nos tropiques. Ce qui ramène au travail accompli, dans le temps officiellement colonial, par la France, qui, grâce à ces complicités locales, a fabriqué des hommes de main locaux, capables de couvrir ses intérêts, jusqu’au bout. Des commis, des administrateurs, des leaders d’opinions, des hommes d’affaire, des petites mains, dont le seul rôle est de pérenniser la tragédie de la domination, dans la conscience endormie d’un peuple comme le nôtre.
Ces hommes et ces femmes ont lentement été amené(e)s à perdre leur discernement, à ne plus savoir ce que signifie les termes de justice et d’équité. Sur eux trône le spectre de la cravache, du mbida mbe, du fouet, une arme fatale, qui s’accompagne de crachats, de menues monnaies, de petits intérêts. Histoire de s’assurer qu’aucune de ces créatures, ainsi domestiquées, ne voudra revenir à son humanité première. Ce qui risquerait de perturber le jeu de la domination en cours. Qui sait ? Quelqu’un pourrait parler de révolte, voire de révolution. D’ailleurs, Ali Soilihi[3], fils de Mtsashiwa, fut un bel exemple de « perfidie anti coloniale ». Du jour au lendemain, il a voulu, comme atteint d’une forme de rédemption soudaine, arracher la laisse à son maître. Il n’a pas fallu trois ans pour qu’on le fasse taire. Un bel exemple de ce qu’il ne faut pas faire en politique aux Comores. Revendiquer sa souveraineté, pourtant consacrée dans les arènes internationales. Ali Soilihi est mort, pour avoir dit non, à la puissance française, et pour avoir dit oui, au droit de se réinventer. Pour avoir aussi refusé de confondre la violence d’un Etat partenaire avec une main tendue. Pour Ali Soilihi, il fallait rompre avec la tutelle et imaginer d’autres horizons. Il a fini six mètres sous terre…

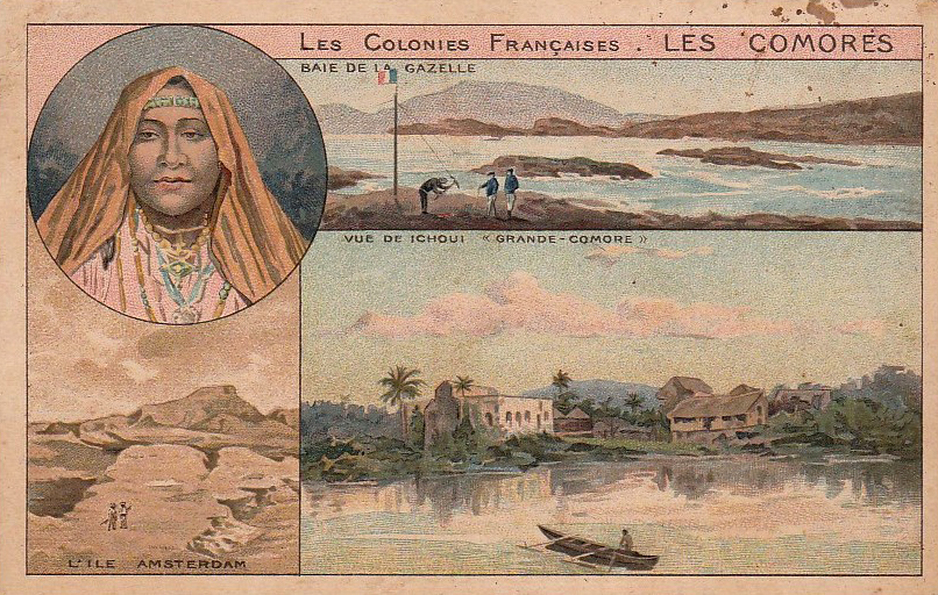
Il n’y a pas si longtemps…
Re expliquer aux régimes suivants, à ses successeurs, à ses concitoyens, qui c’est qui mène au jeu, et qui doit plier, ne fut pas difficile, par la suite. En 40 années d’existence, le Comorien a vu son destin lui échapper. A chaque jour, une nouvelle utopie étatique, tracée et consacrée par le même partenaire historique, dans l’ombre d’une dispute devenue séculaire. Les dividendes, bien sûr, vont aux mêmes. Mais comme elles prennent de la valeur, grâce aux équations complexes d’un monde jamais avare de nouvelles tablettes de profits, elles permettent de redistribuer quelques miettes de pouvoir aux marionnettes en faction. La France tient ce pays, et les Comoriens le savent. Le problème, c’est qu’ils ne peuvent le dire, sous peine de passer pour des « anti français primaires ».
« Anti », un terme spécialement inventé pour disqualifier tous ceux qui s’imaginent une autre relation, en lieu et place de la domination versatile d’un pays puissant sur un autre plus faible. Soyez « pro » et vous finirez par mériter votre place dans la fable de l’indépendance tronquée. Soyez « anti » et vous aurez tous les malheurs du siècle sur vous. Mieux vaut éviter, si vous ne voulez pas être l’homme à abattre. Mêmes les vôtres, ceux que vous pensiez être les vôtres, vous tourneront le dos, par un pur réflexe de survie. Les Comoriens disent bien que « mwelevu na ngwe kakozo »[4]. Et personne n’ira comptabiliser le nombre de Français, qui sont « anti », simplement parce qu’ils trouvent injuste l’action de leur pays aux Comores[5].
Ainsi, ils sont des milliers de Comoriens à servir la soupe au maître, pour éviter d’être considérés parmi les « anti ». Ils vont, tête baissée, tous les matins, saluer cette « Mère-Patrie » qui, jamais, ne sera la leur, pour les raisons que l’on sait. On n’a qu’un pays et on ne le choisit pas. Le salut, peut-être, consiste à l’apprécier, à s’inventer des raisons de lui être fidèle, à lui offrir un horizon de vie meilleure, à lui maintenir la tête debout, hors de l’eau. Les Comores recèlent de tant de richesses que l’étranger y aura toujours une place dans l’imaginaire des riverains. Ceux-ci pourraient envisager d’en profiter, en tissant d’autres relations que celles, imposées, par la fabrique coloniale ? Pourquoi ne se voir uniquement qu’à travers l’image de l’esclave ? Du chien tenu en laisse ?
Ali Soilihi mort, l’image de Tumpa est revenue hanter les vivants[6]. Zampara Tumpa zitso hupara ! Ahmed Abdallah sacrifié par ses sbires, sous le contrôle des services secrets français. Taki Abdulkarim empoisonné à Marbella, par les mêmes réseaux. Avant lui, il y aurait eu le Prince Saïd Ibrahim. Puis il y a eu Saïd Mohamed Djohar, déporté à la Réunion par les forces françaises. Ce qui n’est pas sans rappeler le cas du père de Saïd Ibrahim, Saïd Ali Mfaume, également déporté. La fatalité revient à penser que tout chef d’Etat comorien, mettant la relation avec la France en péril, se taille un destin de martyr potentiel. Pourquoi vouloir changer la donne ? La France est un pays ami, non ?


Feu Ahmed Abdallah, entouré de son gouvernement, et de son chien de guerre attitré, Denard. Macron et Azali, le bal continue…
« Ces événements, ces drames, de la relation franco-comorienne », pour reprendre le propos du journaliste Ali Moindjie, « impactent la psychologie des politiques comoriens. Rares aujourd’hui sont les décideurs comoriens qui prendraient le risque de poser un acte public, prendre une décision, prononcer un discours sans s’interroger sur la perception et la réaction du Grand Oncle ». Les Comores sont une société matrilocale, peut-être est-ce la raison pour laquelle il utilise le terme de « mdjomba mhuu »[7] pour désigner la France, maîtresse intraitable. Moindjie cite un ancien haut magistrat, familier des dossiers politiques : « Personne, en effet, ne souhaite s’attirer ses représailles. En réalité, la relation entre Moroni et Paris n’a guère changé dans son essence depuis la colonisation. Les maitres font un peu plus attention au discours, qui est plus feutré. C’est tout ». Il re cite un enseignant à l’Université des Comores : « Les peurs ainsi créées ne sont pas toutes fantasmées : elles se justifient largement au regard de la violence dont la puissance coloniale a fait preuve au Comores par le passé et ces derniers temps ». Feu Ahmed Abdallah disait, s’adressant à la France : « Nous sommes la viande, vous êtes le couteau, ». Le journaliste en déduit que « le dernier des hommes politiques croit comprendre qu’il est dangereux de défendre [des] positions patriotiques sous peine de tomber ».
Et voilà comment se fabrique la peur dans les consciences. A Maore, une « black list » a gardé en mémoire le nom de tous ceux qui ont combattu pour l’indépendance, aux côtés des autres habitants de l’archipel. Les fameux serrelamen, déportés dans les années 1970. Tous ceux qui figuraient sur cette liste, se sont ensuite retrouvés à la marge, de leur terre de naissance, durant près de 30 ans. Devenus vieux avec leurs rêves de libération nationale, ils ont vu leurs enfants se ranger à l’idée d’une « Mayotte française », défendue par le camp adverse, celui des soroda. Le maître finira toujours par gagner les esprits les plus vaillants. Si ce n’est vous, ce seront vos enfants. Ainsi, va ce monde de dominés.
Un storytelling permanent se charge ensuite d’inscrire ces principes à même la chair de ceux qui naissent ou grandissent. Parfois, en usant d’une violence politique moins directe. Celle des petits privilèges (aide, contrat, bourse, visa, etc.), qui transforme les élites comoriennes en autant de petits soldats de la servitude volontaire. La France essaie d’être là pour longtemps. Elle se saisit volontiers du nombrilisme des petits intérêts, qui divise la fratrie, parce que chacun, au final, se souvient de sa propre gueule, et non de celle du cousin. L’homme est un loup pour l’homme, clamait Hobbes. Le maître n’a qu’à se servir des ambitions des uns et des autres pour régner en toute bonne foi. Qu’est-ce qu’un Etat mendiant ? Qui a retiré « la question de Mayotte » à l’Assemblée générale des Nations Unies ? Qui veut la soustraire au droit international ? Si les Comoriens sont sous la coupe de la France, c’est bien parce qu’ils le veulent, non ? Voilà en tous cas ce qui explique que le pays soit rendu au même endroit depuis 1975. Encore et toujours sous tutelle, et l’indépendance n’étant plus que fable de cuisinier aux ordres du maître.
Soeuf Elbadawi
Image en ouverture : la silhouette de Denard, debout de dos sur la jeep, de dos, lors d’un défilé de l’armée nationale comorienne.
[1] Cf. la chanson d’Ali Affandi, dans les années 1980 : « Na nambiwa bo wana/ emana yarisama/ ndjema zalo hamgu hau nde ze nfaida ». Dites, chers enfants, cette France tient-elle à nous, par la grâce de Dieu ou pour ses intérêts? C’était l’époque du msomo wa nyumeni et de l’ASEC.
[2] « Le travail du blanc [le maître, s’entend] jamais ne se termine, excepté lorsque vous êtes finis et virés ». Il semble que ce conseil aurait été donné à feu Fundi Abdulhamid. Une anecdote rapportée par l’historien Damir Ben Ali.
[3] Le père de la révolution comorienne, 1975-1978. Assassiné par la bande à Denard.
[4] « Qui se laisse traîner par la corde, ne souffre point ». Un vieil adage qu’on fait remonter à la geste, le petit poisson sans cerveau.
[5] Relire François-Xavier Verschave et Pierre Caminade de l’organisation Survie, le professeur André Oraison ou encore le député français Noël Mamere. Ils sont beaucoup à penser que la justice d’une relation entre nos Etats respectifs changerait le cours de plusieurs vies. Sont-ils vraiment des anti-français primaires ?
[6] L’esclave révolté contre le sultan qui a fini tête tranchée par une noblesse jalouse de sa superbe.
[7] L’aîné des oncles.
