Mémoire courte. Dans la situation actuelle à Maore, on en oublie l’essentiel de ce qui a pu être dit par le passé. Avant l’ultime drame. Anthropologue et philosophe, Denetem Touam Bona a vécu à Mayotte. Il en est plus ou moins sorti depuis. Quand il a publié dans le numéro 3 du journal Uropve en mars 2016, il sentait venir le vent mauvais. Nous republions ce texte ici.
Le 1er janvier 2014, Mayotte est devenue la 5ème Région Ultrapériphérique de l’Union Européenne. Mais qui connaît cette île en Europe ? Peu de gens sans doute, y compris en France métropolitaine. Combien de fois des amis devant m’adresser un courrier ont du expliquer à la postière alsacienne que Mayotte n’était pas une île de la Méditerranée (Majorque) mais un département français de l’Océan indien. Mayotte reste aujourd’hui encore dans l’angle mort de la France : un territoire absent des rayons des librairies, des écrans de cinéma et de télévision, des préoccupations et de l’imaginaire de l’Hexagone. Loin des yeux, loin du cœur…
Il faut un mouvement social de 45 jours ponctué de scènes de pillage (2011), ou la prophétie démagogique d’un Mansour Kamardine annonçant une guerre civile imminente[1], pour que les médias français daignent braquer le projecteur sur ce fragment de lave perdu dans le canal du Mozambique. D’où un certain malaise mahorais, bien plus profond que les mille et une difficultés économiques et sociales (chômage abyssale, système hospitalier et éducatif au bord de l’implosion, croissance exponentielle des cambriolages et agressions) que rencontre ce territoire, un malaise indicible touchant au sentiment même de l’existence : « J’ai beau renier mes frères, j’ai beau cracher sur leur indépendance de merde, j’ai beau arborer le drapeau français et chanter la Marseillaise, je reste invisible aux yeux de la Mère-Patrie, au point qu’il m’arrive souvent de douter de ma réalité ». Mayotte souffre de ne pas être reconnue par la lointaine Métropole, alors même qu’elle ne veut plus se reconnaître dans ses îles sœurs.
Si Mayotte est si méconnue en Europe, c’est sans doute parce que le « Mahorais », en tant que spécimen humain distinct du « Comorien », n’existe pas encore ; il est en cours de modelage à partir d’images, de récits, d’une réécriture de l’histoire visant à mettre en scène et à faire exister aux yeux du monde un « peuple mahorais ». De quoi justifier la partition de l’archipel des Comores au bénéfice de la France. Dans les salons internationaux du tourisme, des hôtesses mahoraises souhaitent karibu aux Tour operators et clients potentiels. Leurs dépliants invitent à l’exotisme : « Cédez à la tentation de Mayotte, l’île aux parfums, l’île aux makis… Son lagon offre une aire où dauphins, baleines et tortues marines aiment à voguer. Venez aussi à la rencontre de la population autochtone : les Mahorais ont l’âme gaie, tout y est encore authentique ».

L’« autochtone » des guides touristiques, c’est la nouvelle figure du « bon sauvage » : un être doux et spontané, à peine entré dans l’histoire. L’accession du « Mahorais » au statut de Français domisé (Département d’Outre Mer) procède d’une « naturalisation » de ce dernier, d’une réduction à la nature. Dans les agences de pub et les bureaux d’étude de Mamoudzou ou de Paris, des « Métros » s’attachent à retravailler l’image, le design, le packaging de Mayotte. Il s’agit de définir cette île non pas à partir d’une culture qui, de fait, est archipélique (ce qui remet en question la partition), mais à partir d’une nature présentée comme édénique, une nature hors du temps car désancrée de l’histoire millénaire d’une civilisation du boutre. La promotion d’une « Mayotte île au lagon » permet la mise en clandestinité du reste de l’archipel. Le choix du logo de la nouvelle compagnie mahoraise EWA, la « passe en S », est de ce point de vue tout à fait révélateur : c’est le « spot » préféré des plongeurs wazungu, qui représentera désormais toute une île. Ce « S » n’est pas un symbole mais une marque visant à assurer un copyright français sur un espace expurgé de son histoire et de sa culture : un label censé garantir la qualité d’un produit du tourisme globalisé.
« La première chose que l’indigène apprend, c’est à rester à sa place » nous dit Fanon, c’est ce qu’aura appris à ses dépens Mahamoud Azihari (il sera limogé par la suite), le directeur de la SIM (Société Immobilière de Mayotte), dans le différend qui l’a opposé à un de ses locataires, Vincent Liétar. Afin de court-circuiter la procédure de destruction de la maison SIM qu’il occupait, le dénommé Liétar a réussi, en l’espace de quelques jours, à obtenir du Ministère de la Culture l’ouverture d’une « instance de classement au titre des monuments historiques ». Peu importe que ce projet soit mené à son terme ou non, il pose une question essentielle : qui décide de ce qui a valeur de patrimoine, de ce qui doit être conservé pour les générations futures ? Pour l’instant, il n’y a que deux édifices qui ont le statut de « Monument historique » à Mayotte : la Maison du Gouverneur (1880) et la Mosquée de Tsingoni (15ème s.). Et le 3ème monument devrait être une « case SIM » construite dans les années 1980 ?!… Le malaise de Mayotte s’enracine en partie dans le sentiment plus ou moins conscient de dépossession qu’éprouvent ses habitants vis-à-vis de leur propre image, de leur propre définition d’eux-mêmes, de leur propre histoire ; dépossession à laquelle ils collaborent eux-mêmes en se concevant comme radicalement distincts des autres « Comoriens ».
A Mayotte, plus qu’ailleurs, la politique migratoire se nourrit de considérations écologiques : on aimerait tant inscrire le lagon au patrimoine mondial de l’humanité. La protection de la faune et de la flore autochtone exige des gardes forestiers et des gardes pêches prêts à combattre les espèces invasives. Mayotte est donc devenue une réserve naturelle high-tech (radars, hélicoptères, vedettes, etc.) qu’on défend contre les créatures exogènes à l’écosystème du lagon : les kwasa kwasa. L’instauration en 1995 du visa Balladur est le moment décisif de la production du « peuple mahorais » qui, jusqu’alors, n’était qu’un fantasme de l’élite politique locale et des nostalgiques de l’Empire. La chasse aux « Comoriens clandestins », la stigmatisation, la criminalisation, les expulsions dont ils sont l’objet, tout cela n’est que le versant négatif d’une opération de marketing visant à marquer les esprits et les corps : la promotion d’un autochtone imaginaire – le « Mahorais de souche ». Le visa Balladur est le scalpel au moyen duquel on va trancher dans la chair des individus, séparer en eux le bon grain de l’ivraie, au point que « Mahorais » et « Comorien » vont devenir des termes antithétiques. L’« identité mahoraise » se construira alors, de plus en plus, sur le rejet des autres îles de l’archipel. D’où la montée continuelle d’une xénophobie paradoxale s’exerçant d’abord sur les membres de la fratrie : ceux qui partagent la même langue, les mêmes confréries soufis, les mêmes chants et danses (debaa, shigoma, etc.), les mêmes lignages que le dit « Mahorais ».
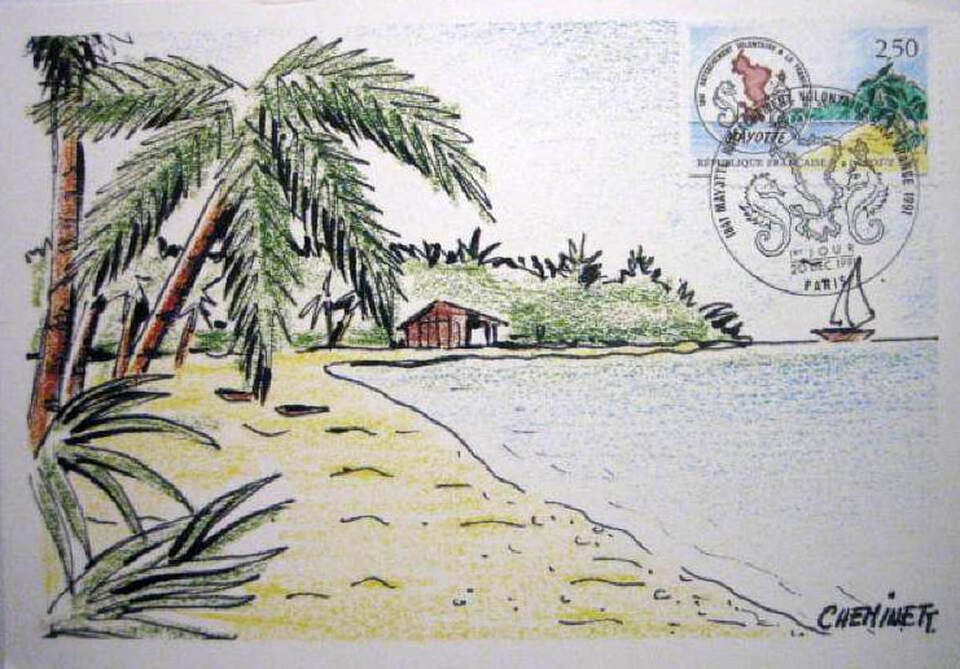
C’est le syndrome du « secret de famille » : il ne faudrait surtout pas qu’on sache que mon oncle est de Ngazidja, ma mère de Ndzuani, ma cousine de Mwali… La source première du mal-être à Mayotte réside ainsi dans le refoulement croissant de la « comorianité » de cette île. Un refoulement qui ne se produit pas seulement dans la psyché des individus, mais d’abord à travers des techniques policières de rafle, d’internement, d’expulsion. Aujourd’hui plus que jamais l’expulsion des « corps étrangers » est présentée comme le remède à tous les maux de la société mahoraise. Le problème avec le refoulé (Freud), c’est qu’il ne cesse de faire retour sous la forme d’une violence interne à l’individu qui refoule : somatisations, troubles du comportement, psychoses. Dans le cas de Mayotte, ce retour du refoulé s’exprime notamment dans la multitude toujours plus nombreuse des « mineurs isolés » : les enfants des rues et des bois, les enfants du rejet qui grandissent, la rage entre les dents, loin de leurs parents refoulés.
Des parents d’élèves de Boueni expulsent des enfants d’« Anjounais » de leur école, une centaine d’habitants de Tsimkoura s’habillent en rouge pour traquer les « clandestins », des bandes de jeunes de Cavani et de Gombani s’affrontent des heures durant à coup de batte de baseball ou de machette, des jeunes de Kawéni tendent un guet-apens aux policiers de la BAC, un Président du Conseil Général (Zaïdani) se fait « emmerdé » (de bouse de zébu) par de jeunes agriculteurs en colère, des randonneurs wazungu se font dépouiller sur un sentier de Saziley, un collectif « ni clandestins, ni putes, ni voyous » se monte à Chiconi contre les Malgaches, une dizaine d’enfants des rues tabassent et volent une serveuse de Mamoudzou : la schizophrénie développe partout ses métastases, il n’y a plus de confiance mais une défiance généralisée qui alimente la spirale des tensions. « Cette agressivité sédimentée dans ses muscles [liée à une violence retournée contre soi], le colonisé va la manifester d’abord contre les siens. C’est la période où les nègres se bouffent entre eux … »[2]. Une île désancrée de son archipel ne peut que partir à la dérive…
Denetem Touam Bona
[1] Figaro du 19 janvier 2016.
[2] Fanon.
