L’auteur comorien le plus consacré de l’histoire des lettres francophones vit à Montpellier en France. Dérangé que je suis, son troisième et dernier roman, sorti chez Tripode, a reçu le prix France Télévision 2019. Cet article est paru dans le n°5 du magazine Mwezi en juillet 2020.
Zamir, son chapeau et son air de poète transi. Une sorte d’icône des lettres francophones que personne n’a cherché à imaginer dans l’archipel depuis la parution du premier roman comorien d’expression française en 1985. Plusieurs fois primé dans les raouts littéraires, exhibé par les critiques de la place de Paris tel un phénomène de foire, Zamir est de plus en plus salué par les lecteurs du pays de Molière.
Dérangé que je suis, son dernier opus, a reçu le prix Roman France Télévision en mars 2019, grâce à un jury de téléspectateurs éblouis. Neuf voix acquises dès le premier tour. « C’est assez rare » reconnaît François Busnel, animateur de La Grande Librairie – émission consacrée aux livres – sur France 5. Les jurés, selon lui, « ont défendu leur livre avec des arguments très forts. Et ils ont fait un choix audacieux, avec cette envie de défendre un auteur peu connu, et une petite maison d’édition. Ils ont évité tous les pièges d’un jury de lecteurs. C’est l’instinct et l’émotion qui ont primé sur l’analyse ou l’éloquence, et c’est pour cette raison aussi qu’il ont fait ce choix sincère et audacieux ».
Ainsi Zamir force-t-il le respect du microcosme, obligeant la profession à admettre que le miracle peut encore surgir des sentiers battus et rebattus de la littérature. Car qui aurait pu songer à un tel succès ? Aux Comores, Zamir était un inconnu, il y a encore dix ans. Né en 1987, il aurait grandi à Mjihari, du côté de Mutsamudu, entouré de livres, grâce à un père, directeur d’école, et à une tante, libraire. Anciennement employé dans la culture à Ndzuani, Zamir a effectué ses études de lettres au Caire, où il a écrit son premier roman, paru aux éditions du Tripode en 2016. Prix Senghor, également honoré d’une mention au prix Wepler, Anguille sous roche – son titre – campait l’histoire d’une jeune femme noyant ses souvenirs dans une tragédie sans nom. Celle des kwasa. A l’époque, les rares lecteurs comoriens lui reprochent de ne pas assez s’attendrir sur le sort des victimes du Visa Balladur, alors que les lecteurs français, eux, se laissent séduire par ses audaces langagières.

Zamir.
Surfant sur ce premier succès, Zamir publia son second roman, Mon étincelle, qui vint confirmer l’intérêt des critiques. Même éditeur – Le Tripode et même approche de la langue, à l’occasion d’une résidence d’écriture de trois mois à Montpellier, où il décide de s’établir, désormais. Cette fois- ci, la narratrice, au sortir de l’adolescence, surprit son lecteur, en jouant à Shéhérazade dans un avion au bord du crash : « Pour l’auteur que je suis, elle permet de représenter l’espoir qui manque à moult sociétés, dans moult pays. On y attend le changement en vain… Le désespoir s’installe et on préfère partir, dans des conditions parfois inhumaines ». Zamir en profite pour préciser son grand projet, pour lequel il tord le cou à la langue française : « La littérature est une façon de donner la parole à ceux qui ne l’ont pas et de tendre la main aux autres. En écrivant, je dis et j’affirme que nous pouvons vivre ensemble et partager, librement ». Il reste humble : « Je ne m’attendais pas à un tel succès, mais il est hors de question de me reposer sur mes lauriers. Je ne me considère pas du tout comme un grand écrivain ».
Sur son troisième et dernier roman, Dérangé que je suis, Zamir poursuit néanmoins ses délires dans cette langue fleurie et désuète, archaïque et savante, populaire et alambiquée, « néologisante » à souhait, qui fait son succès et à travers laquelle s’agitent des personnages aux noms pour le moins improbables. Ainsi de Dérangé, un docker s’exprimant depuis le container dans lequel il a été jeté. Un faux simplet, qui a le verbe haut en couleur. Une histoire où se racontent ses chemises et ses pantalons troués, lui servant de calendrier portatif, au port de Mutsamudu. Dérangé et son chariot rafistolé (« CaRleWis ») emportent des colis et des bagages dans un quotidien où trône le diabolique trio des Pipipi (Pirate, Pistolet et Pitié) et où apparaît une dame patronnesse (l’« amphitryonne »), qui « ravage tout sur son passage » et qui le perdra, d’autant qu’elle parvient à réveiller son « serpent ». Sa « petite queue bavarde ». Son « insolente matraque ». Et on ne déflorera pas l’histoire…
Avec ce récit, mi-témoignage, mi-confession, à l’image des précédents romans, Ali Zamir porte son singulier regard sur un bout d’archipel dont on cause si peu, et pas qu’en littérature. Zamir parle des réprouvés, un sujet pour le moins délicat à Ndzuani. Dérangé, personnage risible, s’il en est, voit son destin chamboulé par un usage déjanté de la farce tragique : « Il faut toujours une goutte d’amertume, dit- il, pour faire déborder ce vase qu’est le cœur et donner une saveur de tonnerre de Dieu à son existence. Creusé d’humeur noire jusqu’au bout des ongles, mon corps n’était qu’un abîme de peines ». Solitaire, mal-aimé parmi les mal-aimés, traité de « tardigrade » par ses détracteurs, Dérangé va se retrouver pieds et poings liés dans une situation embarrassante. Quid de la fin ?
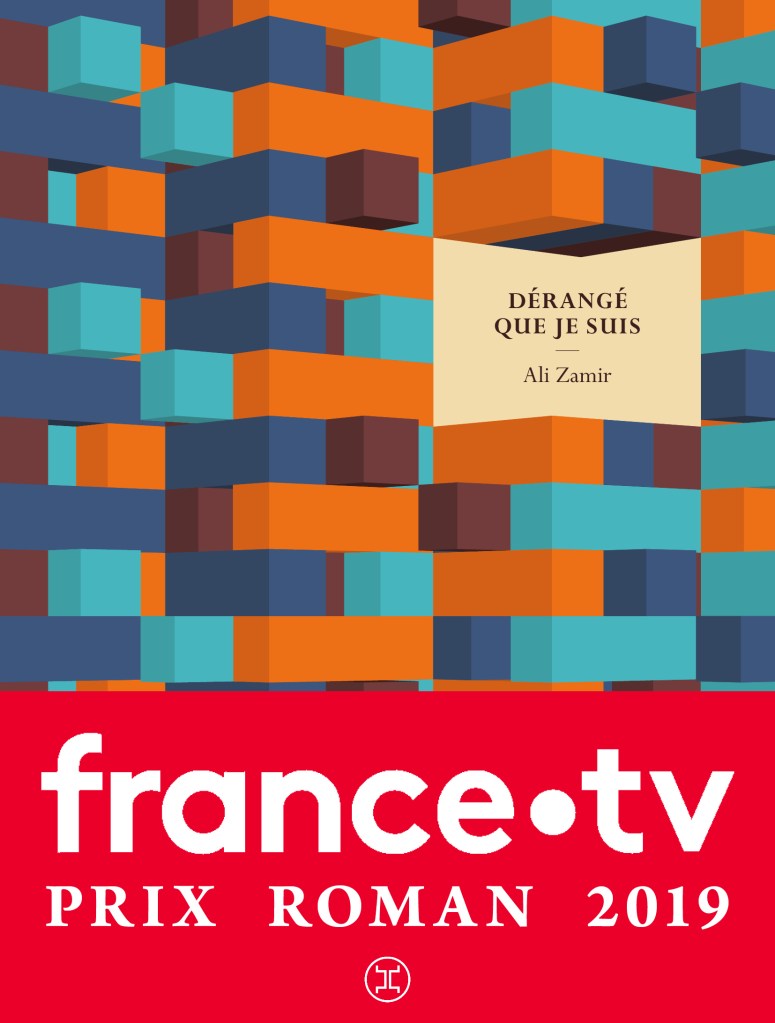
Un texte à lire…
Les Comoriens ne fréquentent guère les livres, en dehors des saintes écritures, et ne se figurent que difficilement la fin d’un tel récit. Ce qui explique le paradoxe Zamir. Son succès – le premier buzz du genre pour la littérature du cru – n’interpelle que peu ses concitoyens d’archipel. Va-t-il à l’instar de Salim Hatubou, le plus marseillais des auteurs comoriens, devenir le plus montpelliérain d’entre eux ? Malgré ses consécrations littéraires, Ali Zamir, devenu le héros d’une diaspora culturelle qui n’est pas toujours appréciée par les siens, n’a jamais cherché à disserter sur son rapport à la terre d’origine. Il laisse ses lecteurs se débrouiller sur le sens de tel ou tel phrasé, en rapport avec son quartier de Mjihari, où reposent tellement de frustrations, tout comme il laisse les défenseurs de la langue de France se débrouiller avec son écriture. « Je tends une main au lecteur pour lui permettre de se faire sa propre idée du récit, cependant ».
Il en découle parfois des non-dits. De sa première œuvre, le président Macron, sous la coupole de l’Académie française, avait dit qu’elle traduisait « une expérience du monde qui aurait pu rester enfouie comme cette anguille sous roche dont parle Ali Zamir dans un récit éblouissant ». Qui se cache sous l’anguille, aurait-on envie de demander ? Sauf que Zamir lui-même n’en oriente pas le sens. Comme s’il voulait laisser à ceux qui s’y attachent le soin de raconter ce qu’ils souhaitent. Adapté au théâtre par Guillaume Barbot en 2018, Anguille sous roche avait donné l’impression de sombrer dans des tragédies de migrants en Mer Méditerranée, au lieu de célébrer son ancrage dans un espace où la France entretient encore son aura coloniale. Tout dépend de qui le lit ! Ce qui le rend encore plus universel, semble-t-il…
Sans doute que Zamir interroge les drames de son pays, mais il trouve le moyen d’en rire, sans forcer le trait. « C’est quand même un pays où les gens essaient de s’enfuir pour trouver une vie meilleure, et lui, il réussit à nous faire rire » commente un lecteur. « C’est vraiment un écrivain qui dépote ! » souligne un autre. « Il est jeune, Comorien et s’est réapproprié la langue française de manière extraordinaire », relèvent-ils. Un dernier mot qui rappelle ce qu’il avait confié au Figaro à ses débuts au sujet du français : « C’est une langue qui a fait ce que je suis aujourd’hui et je ne sais pas ce que je deviendrais sans elle. Je ne connais aucune autre langue qui me permet- trait de dire exactement ce que je veux dire ou ce que je ressens ».
Med
