Historien spécialiste des traditions orales, Moussa Saïd ne pense pas que celles-ci sont en train de disparaitre. Entretien paru dans le journal Kashkazi n° 46 en juin 2006.
Moussa Saïd, vous êtes historien à Moroni, spécialiste des traditions orales. Si vous deviez définir en quelques mots la tradition orale, que diriez-vous ?
Moussa Saïd : Je préfère vous répondre par une histoire. Mbayé Trambwe, conteur philosophe comorien du XVIIIème siècle, transmettait ainsi la sagesse à ses petits enfants. « Si vous restez tranquilles, je vais vous raconter ce qui tue l’amitié. Ce qui tue l’amitié, ce sont les pieds lourds ». La mémoire collective a su transmettre de génération en génération l’essence du patrimoine culturel de l’archipel et le lieu de cette transmission était le foyer ancestral où se tenaient les veillées récitatives au cours desquelles les grandes personnes racontaient le passé aux petits enfants. C’est dans cet espace que la tradition a été conservée et transmise à travers les contes, les mythes fondateurs, les chants des djinns sources importantes qui nous permettent de connaître les premières populations. Il y a aussi un genre peu connu, les contes des bouffons. Ces gens qu’on disait idiots, mais qui étaient de véritables critiques vis-à-vis de la société et du règne des sultans. Voici un exemple de ces contes, celui de « Soumbi » est édifiant. Un jour, le sultan appelle ce bouffon, lui présente un collier de tessons de verre en lui faisant croire que c’est un collier d’or et qu’il pouvait enfin se marier avec cela. Soumbi refusa l’offre en expliquant au sultan qu’il ne pouvait accepter un collier d’une si grande valeur. Si les gens me voyaient avec cet or pur que diraient-il ?
Vous affirmez que les cérémonies publiques sont les canaux de transmission de cette culture par excellence de cette culture ?
Ce sont aussi des registres qui permettent de recueillir le vieux parler comorien -le shiduwantsi-, mais ces véhicules restent idéologiques. On vante par exemple la généalogie des époux alors que dans le foyer ancestral, la transmission se fait tout naturellement. A la question d’un enfant, les parents répondent comme l’a fait Mbaé Trambwé. Cependant, je suis partisan de ceux qui veulent reformer le grand-mariage pour qu’il soità la portée du grand nombre. Cela permettra de perpétuer les cérémonies et avec elles des formes de transmission comme les danses traditionnelles. Si le grand mariage reste une surenchère, cela tuera ces véhicules-là.
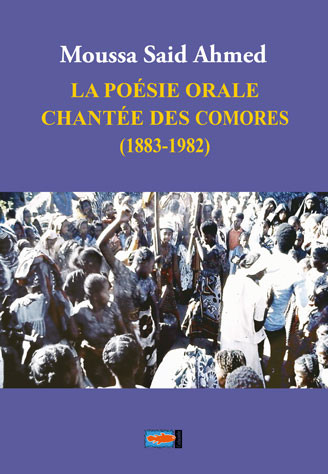

Pensez-vous que ces traditions sont menacées de disparition ?
Je préfère mettre le terme “disparaître” entre guillemets et parler plutôt d’une position de faiblesse par rapport à l’émergence des nouvelles technologies. Parce que celles-ci ont bouleversé les comportements, la tradition orale ne peut plus être véhiculée par les mêmes canaux. Il faut s’adapter et sauver les meubles comme disait Léon Blum. Le problème majeur que nous avons c’est de pouvoir faire reconnaître localement qu’il s’agit d’une source sérieuse de savoir. Si au niveau mondial, les chercheurs connaissent le poids scientifique de l’oralité, on nous considère ici encore comme des fous, des idiots qui passent le temps à transcrire de vieilles histoires.
La place qu’a prise l’écrit ne risque pas de créer une rupture entre deux univers culturels, celui des anciens et celui des nouvelles générations ?
Je ne crois pas. La tradition orale repose sur des critères pour être reconnue. Je peux vous citer le « Mnatrengweni » qui évoque celui qui a les bonnes manières, qui sait se comporter en public, qui a des relations. On retrouve l’équivalent dans la culture de l’écrit. Dans chaque cas, il s’agit de valeurs universelles. Les détracteurs ont l’impression que la tradition orale confisque l’individu ? C’est une fausse interprétation. Dans la structure sociale, l’individu est identifié au sein du groupe générationnel. Quand ont été condamné à payer le présent d’excuse pour réparer une faute, on le fait individuellement. Nous avons aussi l’exemple du poète itinérant Ipvessi Bungala. Ce rebelle qui a participé à la révolte de 1915 a été arrêté, jugé à Mayotte et exilé à Madagascar. Au cours de la traversée, il a chanté sa propre Kamal’Eddine Saindouhistoire.
Finalement, la tradition orale pourra-t-il survivre sans ses propres supports ?
Il est clair qu’on ne peut pas continuer à faire des veillées récitatives comme avant. Mais il y a mille autres solutions comme ce dossier que vous faites. Qu’est-ce qui empêche les nombreux médias qui fleurissent dans les villages comoriens d’entrer dans les quartiers, enregistrer des contes et les diffuser. Je ne suis pas contre ce que font ces médias, mais il y a trop de futilités. Un projet de radio campus est en gestation à l’université, je pense que c’est le cadre idéal pour faire la promotion de la culture orale et poursuivre ce qu’ont fait les générations précédentes, mais avec nos moyens à nous. On n’a jamais été mieux équipé qu’actuellement pour conserver l’oralité, si nous apprenons à utiliser les outils modernes.
Propos recueillis par Kamal’Eddine Saindou
DES CODES DE PAROLE PLUS OU MOINS RIGIDES SELON LISA GIACHINO DANS LE MÊME NUMÉRO. Dans une société où la hiérarchie sociale régissait la prise de parole, la veillée était un ballon d’oxygène. À quel point la prise de parole était codifiée dans la société traditionnelle ? Les avis sont partagés. Pour l’auteur de théâtre Alain- Kamal Martial, « il y avait une dictature de la parole, des codes terribles. On ne commence pas un conte n’importe comment… et on n’imagine pas des enfants prendre la parole. Il y avait une dictature très institutionnalisée du père, de la mère, de la haute classe sociale. Et ne disait pas un conte qui voulait : il fallait être d’une famille de conteurs. » « On prenait la parole au sein des hirimu, les classes d’âge », nuance l’écrivain Nassur Attoumani qui rappelle le contexte de cette codification de la parole : « Quand on était face aux grandes personnes, on était là pour apprendre. On n’avait pas un savoir au-dessus d’eux. L’intelligence était retransmise par les aînés. L’expérience du vécu comptait énormément. Un jeune, qu’il aille dire quoi ? » « Il n’y a pas de conteur professionnel au sens strict du terme dans cette société », précise aussi Soeuf Elbadawi, également auteur et comédien. « La veillée est un. moment de partage pour tout le monde. Il n’y a pas une figure tutélaire de griot comme en Afrique de l’Ouest. Mais chacun raconte une histoire, avant de laisser place aux autres. Bien entendu, il y en a toujours un qui connaît plus d’histoires, grâce à grand-mère, et qui sait mieux raconter. Celui-là, on l’invite toujours dans les veillées pour être sûr que la magie fonctionne. » Et d’évoquer des souvenirs où la dictature des grandes personnes paraît douce : « J’ai connu les dernières veillées de conte, où tout le monde, de l’enfant à l’adulte, devait y aller de son petit conte ou de son chant. Avant une veillée, la grand-mère ou la tante vous apprenait un conte pour que vous ne soyez pas en reste. Et tout le monde vous écoutait. Il y avait un apprentissage de la parole et de l’écoute. Par la suite, moi qui suis urbain, à Moroni, je me suis rendu compte que l’esprit des veillées est quand même resté dans certaines discussions sur les places publiques ou dans certaines familles, où vieux et jeunes se mêlent de raconter chacun sa petite histoire à l’assemblée. » Où l’on se souvient de quand Kani-Keli rejouait ses veillées au clair de lune. En 1985, peu après l’arrivée de l’électricité et de la télévision au village, des jeunes de Kani-keli, au sud de Maore, ont eu la nostalgie de la vie communautaire de leur petite enfance. L’association Grofolk est née. « On organisait des journées entières avec tamtam boeuf le matin, des chants, des danses, et le soir une veillée où on invitait des conteurs de différents villages », se souvient Bacar Abdou Ntro, qui était encore enfant à l’époque et garde jalousement les cassettes vidéos des fêtes des années 90. « A l’époque, les contes avaient déjà commencé à disparaître. Dans l’ancien temps, on jouait tous les soirs sur la place publique et pendant les pauses, les vieux contaient. J’ai connu un petit peu ça, en 1981, 1982. Il n’y avait pas encore l’électricité. Nous qui avons connu ça, on a ressenti le besoin de montrer aux plus jeunes comment c’était. » Pourquoi ces veillées quotidiennes ont cessé ? « C’est venu de tout le monde je crois. Même les vieux n’ont plus senti ce besoin, on ne se retrouvait plus le soir au clair de lune, chacun, le soir, était chez soi avec sa petite famille. » Et l’association ? « Elle continue, mais ce n’est plus la même ferveur. Chacun, maintenant, a ses occupations… » Et le théâtre dans tout ça justement ? Bacar Abdou Ntro, instituteur à Kani-Keli, au sud de Maore, et membre de la troupe Les Enfants de Mabawa, a en effet commencé à jouer en 1986. « On n’appelait pas vraiment ça théâtre. Ça se faisait déjà à l’époque des veillées, on jouait des petites scènes qui racontaient la vie quotidienne. Les vieilles dames jouaient avec les jeunes, et aussi des vieux qui sont aujourd’hui djaulah et qui ne veulent plus en entendre parler. On improvisait, ou on essayait de se souvenir des dialogues à l’oral. On n’écrivait rien. C’était des sketches d’une ou deux minutes, surtout pour faire rire, on était dans l’amusement. On prenait quatre piliers, on montait l’estrade et on attendait que la lune se lève… C’était pour beaucoup de l’imitation : on va imiter mon grand-père, ma grand-mère… On s’habillait comme eux à la campagne, avec des vieux vêtements déchirés. » Ces parties de rigolade préfiguraient-elles de nouvelles formes d’expression de l’oralité ? Elles annonçaient l’avènement du théâtre…
