La sortie récente de 50 ans[1], le dernier livre de Soeuf Elbadawi, aux éditions Quatre Étoiles, a été une nouvelle occasion de se retrouver au Muzdalifa House, pourtant fermée depuis dix ans, afin de questionner le pays et sa mémoire. Au programme : échanges musclés avec l’auteur et premières réactions des lecteurs de ce dernier ouvrage.
Un texte dense, sensible, d’après l’éditeur. « Soeuf Elbadawi célèbre un demi-siècle d’existence de l’État comorien, en mêlant l’intime au politique, la mémoire personnelle aux enjeux collectifs. Il livre une méditation poétique et engagée sur le temps, l’identité, les espoirs et les tourments d’un peuple, le sien. Les mots, choisis avec soin, deviennent des éclats de lucidité et d’émotion, nourris par les vibrations de l’histoire comorienne et les fulgurances d’une langue forgée dans l’exil, la résistance et la quête de sens. Un texte bref mais profond, à lire comme un chant d’anniversaire et de vigilance ». C’est dit, en termes simples, choisis. Qui donnent envie de nous plonger dans ces cent vingt-huit pages, d’où l’on ressort avec des ah, des oh et autant de questions qui fâchent. L’auteur semble avoir une capacité singulière à vouloir s’interroger.
Figure incontournable de la scène culturelle comorienne, Soeuf Elbadawi y « triture ce que l’archipel draine à la cinquantième bougie de son indépendance », selon Germaine Gertrude, chroniqueuse sur le net. « Quels défis ? Quels ratés ? Qu’a-t-on retenu des acteurs de l’indépendance ? De leur soif de liberté pour le pays ? De leurs compromissions ou demi-mesures ? » L’Histoire versus la fable. Gertrude voit en ce livre « une réflexion acide et sans concessions, y compris à l’égard du peuple comorien et de sa gouvernance ». Un livre éclairant la pensée féconde de l’auteur : « On reste à la marge par moments tant les utopies et le shungu qu’il réinvestit semblent inatteignables. Mais à la fin du livre, le sentiment que nos déroutes doivent se muer en actes fondateurs pour la patrie nous étreint. Chacun sa part, chacun sa pierre à poser, pour une indépendance qui n’attend que d’être parachevée ». Une lecture qu’elle trouve transcendante…

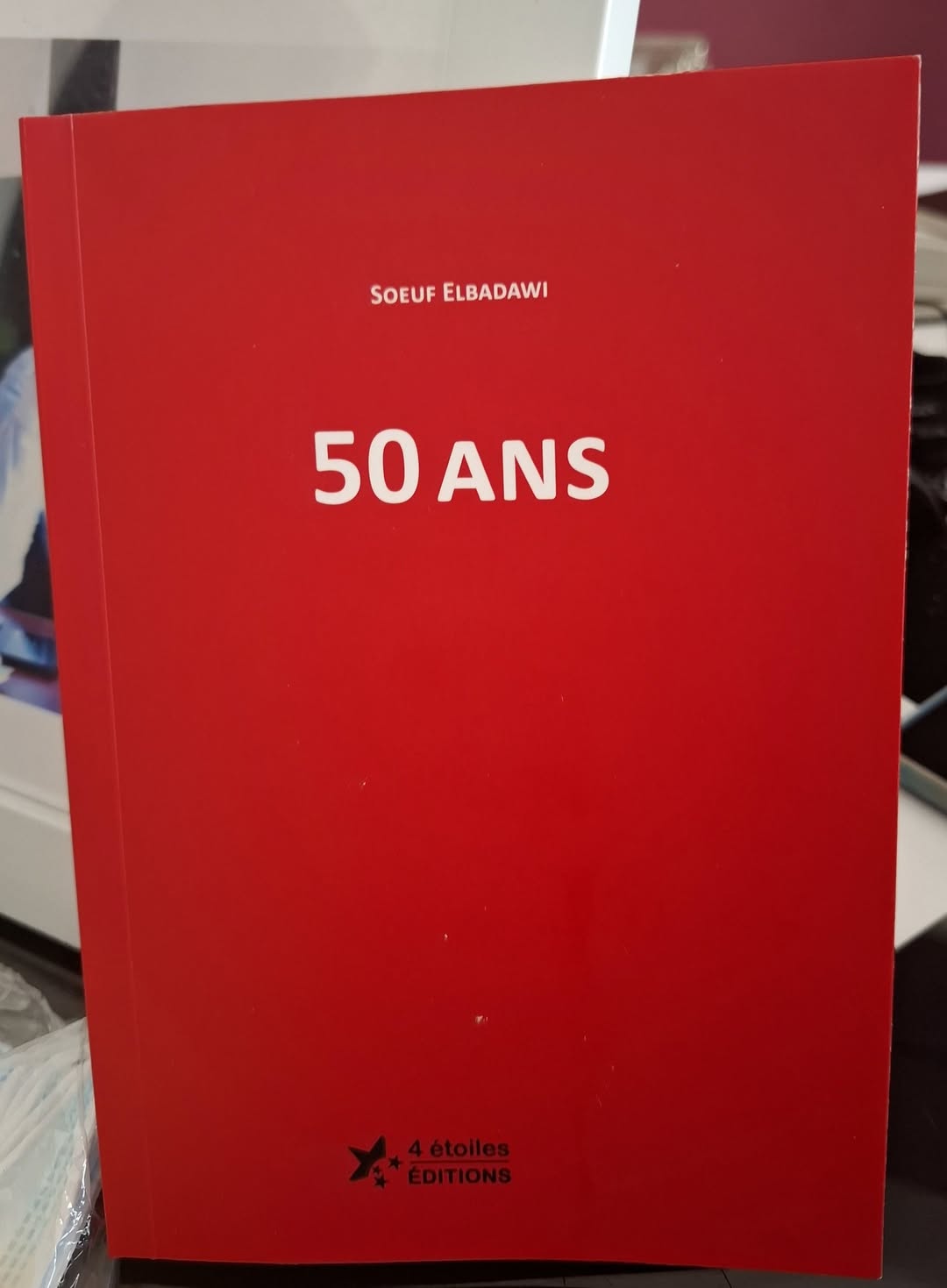

Au Muzdalifa House.
Parfois, la meilleure façon de lire un livre est d’écouter ceux et celles qui l’ont lu. Pour Abdoulbastoi Moudjahid, ce livre « symbolise une rencontre tragique et nécessaire entre deux chronologies : celle de l’homme et de son pays ». Le constat emmène une réflexion : « C’est le récit d’une existence qui a grandi dans l’ombre et la lumière d’une souveraineté encore en quête d’elle-même ». Moudjahid semble formel : 50 ans signale le combat d’un intellectuel qui se refuse au « silence et l’oubli (…) Soeuf Elbadawi porte la voix des non-dits et souligne la responsabilité qui nous incombe face aux désillusions du passé. Son écriture est une veille citoyenne, un acte de résistance contre l’amnésie collective ». L’avocat, qui faisait partie des invités à la présentation du livre au Muzdalifa House à Moroni, le 3 janvier dernier, finit son propos par ces mots : « Nous avons ressenti l’urgence d’une transmission qui dépasse les célébrations de façade pour toucher à l’essence même de notre identité nationale ».
Autre son de cloche, celui d’Ali Moindjie, également convié à cette rencontre autour des 50 ans de Soeuf Elbadawi. « On peut aimer ou détester l’écrivain et artiste Soeuf Elbadawi. On ne peut nier la cohérence de sa réflexion, d’un livre à l’autre et sa capacité à remuer nos tripes ». Pour l’ancien journaliste, l’auteur « invite les Comoriens à changer d’approche vis-à-vis de la colonialité ». Il parle de « remonter à la racine et d’utiliser les outils de l’anthropologie et d’autres sciences pour démêler les raisons des excroissances et désarticulations de cet objet « monstrueux » qu’est devenu le Comorien, qui, rangu pvala hata pvanu, a été et demeure l’enfant naturel du couple féodalité et colonisation ». Ne jamais oublier que la colonialité n’a pas un caractère binaire, souligne Moindjie : « Elle met en jeu une complicité d’intérêts et d’acteurs locaux, qui renforcent la domination. Les prédateurs n’ont pas un seul visage ». Selon toujours, Moindjie : « la situation est d’autant plus inquiétante que le Comorien a rompu la transmission générationnelle, perdant en route » ce qui permettait de régénérer sa culture.



Lors de la présentation des 50 ans à Moroni…
50 ans aborde l’archipel de multiples manières, à commencer par le souci de la trace. Le démembrement à l’œuvre, initiée par les féodaux et les coloniaux, n’a pas permis de préserver l’âme de ce pays. Soeuf Elbadawi évoque tout le long de son œuvre une utopie de cercle, le shungu, que l’historien et anthropologue Damir Ben Ali a été parmi les premiers, sinon le seul à avoir étudié de près, durant ces cinquante dernières années. Un épisode qui semble inspirer sa réflexion et que d’aucuns s’étonnent de ne pas connaître. « Le temps n’est-il pas arrivé d’exhumer enfin nos valeurs centrées sur le shungu ? s’interroge Moindjie. Ce shungu qui a permis aux marins portugais naufragés, aux infortunés boutriers arabes et à différentes tribus bantu de l’Est africain de réussir à créer une société nouvelle, aspirant à vivre ensemble sur ces îles ? » Le shungu, dont le nom dérive du volcan en langue shikomori, représente le socle de cette société, aujourd’hui défigurée à tous les niveaux. Le shungu est synonyme de don et de contre-don, de partage et de solidarité, d’égalité et de cohésion sociale. Il est à l’origine de toutes les pratiques normatives sur lesquelles se fondent ce pays pour tenter de rester debout dans la dignité.
Lors de la rencontre du 3 janvier 2016 au Muzdalifa House, Saindou Kamal’Eddine, journaliste a voulu savoir comment on ré-enchante un espace devenu aussi désert, en parlant du pays. Soeuf Elbadawi a répondu à sa manière : « Il faudrait réinscrire ce paysage dans son utopie originelle. En réinvestissant le champ de la relation et sa complexification. En renouant avec la notion de communauté archipélique. En saisissant l’ultime seconde chance que pourrait offrir le shungu, s’il était re-questionné. Nos aînés ou nos prédécesseurs n’avaient que l’espérance pour boussole, et ça ne fonctionne qu’à plusieurs (…) Aujourd’hui, on voudrait nous vendre l’individualisme et l’accaparement comme formes avancées de maintien de l’homme en ces lieux. Quand on rejoint une logique de cercle, un peu comme pour le hilka du dhikri, il faut accepter de conjuguer le commun avec des éléments du visible et de l’invisible, à la fois. On dit que dans le hilka, il y a ceux que l’on voit, les humains, et ceux que l’on ne voit pas _ des anges et des djinns. Ce rapport au vivant, qui tient compte des invisibles, notre société a toujours fonctionné avec. Mais comme nous avons échangé nos vieilles lunettes contre des grilles de lecture qui effacent la trace, nous sommes devenus aveugles, ne voyant pas l’intérêt de ce qui rassemble, à commencer par cette complexité de la relation, qui fait que nous vivions sans cesse au carrefour des mondes. Ndo pvo ziraruni. Encore faudrait-il tenir compte de nos imaginaires passés ». Il ajoute :« il faut arriver à contrebalancer le narratif dominant. Avec 50 ans, j’essaie de retrouver ma dignité devant l’adversité ».
Med
L’intégralité de l’entretien réalisé par Saindou Kamal’Eddine, lors de la rencontre au Muzdalifa House est disponible sur ce site : https://shungu21.com/2026/01/05/autour-de-50-ans/
L’image à la Une est de Farouk Salami Djoussouf. Les photos au Muzdaliaf House sont de Housni Kassim. celle du livre est empruntée au profil facebokk de l’avocat Moudjahid Abdoulbastoi.
[1] 128 pages, 2025.
