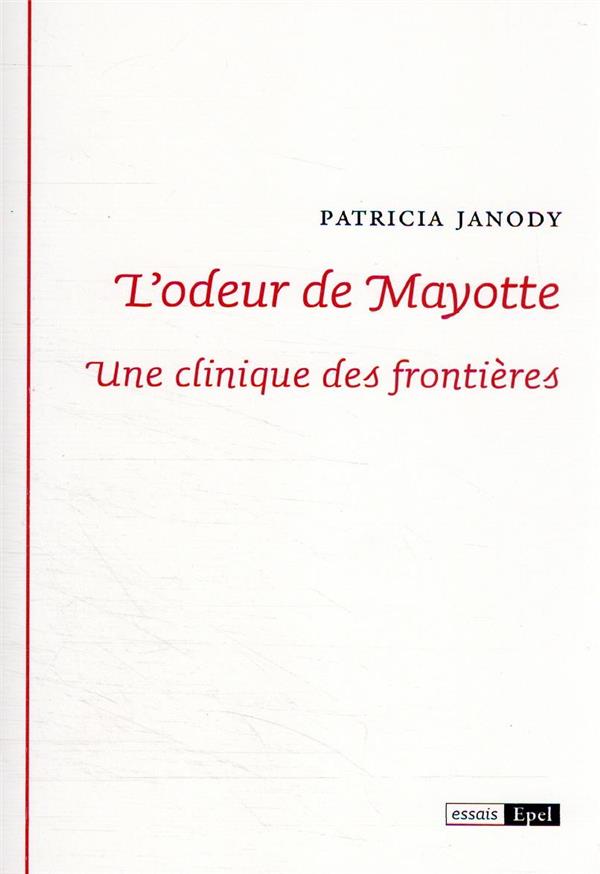Ce livre rend compte de l’expérience d’une clinicienne française dans une société historiquement fracturée. A Mayotte, et plus largement aux Comores, les mécanismes en place se voient amplifiés du fait de la relation coloniale. En parlant de Mayotte française, le livre de Patricia Janody – L’odeur de Mayotte, une clinique des frontières[1] – se retrouve à cheminer dans les interstices d’une histoire non dite, non déclarée, non affirmée. Celle d’une France que ses intérêts obligent à déstructurer une humanité en train de se reconstruire.
Patricia Janody est psychiatre de profession. Son voyage à Mayotte ne relève pas du choix, mais de la conjoncture. Difficile en effet de croire qu’elle ait choisi d’elle-même de s’empêtrer dans cette histoire coloniale au goût inachevé, et au sein de laquelle les usages nourrissent les maux qu’ils sont censés traiter. Mayotte française est un pari, la ramenant à de vieilles lubies, comme « quand il s’agissait de s’emparer d’un morceau du corps de l’ennemi, ou bien, à l’équivalence, de s’emparer de son nom »[2]. Janody se laisse vite surprendre par ce qu’elle y perçoit ou entend, en n’oubliant pas qu’elle fait face à une récurrence du monde colonial : « un questionnement clinique sur les conséquences du colonialisme ne peut manquer d’y repasser ».
A l’endroit où elle débarque, les consultations se mènent à la rude. Au « coude à coude dans de petits locaux non ventilés, avec tables brinquebalantes et chaises en nombre insuffisant », avec des patients malmenés par l’existence. « Certains d’entre eux ont vécu attachés, comprend-elle, jusqu’à l’introduction des soins psychiatriques et des psychotropes, et logent dans des cahutes de tôle ondulée qui concentrent la chaleur »[3]. Habituée aux contraintes de la psychiatrie française, la clinicienne, entre deux banga alignés, comprend que « le dispositif de soins n’est pas séparable d’un dispositif administrativo-politique imposé ». Le service de psychiatrie en est encore au début de son histoire, quand elle s’y intéresse. Excitée à l’idée de prendre part à ce qui ressemble, vu de près, à une expérience alternative, elle fait le rêve « d’une psychiatrie malgré tout plus libre, réinventant son cadre et capable de se dispenser du recours à l’enfermement »[4].
Elle déchantera à la première garde, cependant. Devant l’état d’un patient agité, qui se vautre dans ses propres excréments, sous le regard de soignants, eux-mêmes exténués. L’intuition l’amène à faire venir les pompiers, qui, eux, feront taire les voix dans la tête dudit patient. Lorsque, plus loin, elle rencontre cette matriarche, « qui continue à supporter le lien à la terre d’origine tandis que les êtres chers s’en arrachent »[5], elle avoue, là aussi, un trouble. Possédée, celle-ci convulse, se jette à terre devant elle, bave et voit sa voix se transformer. « Mes genoux attrapés par les mains de la femme, mes genoux puis mes vêtements, elle s’agrippe à moi, son visage se redresse vers le mien, elle est douée d’une vivacité et d’une souplesse soudain hors d’âge, ses yeux chavirent et sa voix, c’est-à-dire la voix qui n’est plus sa voix, monte vers moi, timbres et rythmes modifiés »[6].

Ecritures sur les murs à Mamoudzou.
Tout ceci se passe dans un contexte de pauvreté ultime, dans un ailleurs où les êtres ne sont pas toujours ce que l’on en dit. Janody évoque les invisibles. « À Mayotte, dit-elle, il est fait quotidiennement mention de djinns, que ce soit sur le ton de la crainte, de l’humour ou de la dérision. Esprits organisés en parallèle du monde visible, ils en forment en quelque sorte la doublure ». Une frontière tenue entre les mondes connus et non connus se dessine. Les djinns « se répartissent en esprit de la nature et en esprits de la morts, et sont réputés gourmands, gloutons, avides, capables d’emprunter toutes les formes, animales, humaines ou monstrueuses »[7]. Ils sont là, au quotidien, embrouillant les cartes, pour quiconque s’imagine en terrain conquis. Janody devine le ping-pong, qui se joue entre les deux pratiques, occidentale et traditionnelle, en ces lieux. Le processus « s’impose aux nouveaux arrivants au titre d’une rupture, ou du moins d’une tentative de rupture, avec les usages coloniaux qui, en sus de leurs lois, imposaient aussi leurs modèles de traitement »[8]. Ainsi narre-t-elle sa rencontre avec Mayotte et ses fantômes crapahutés entre deux rives.
Dans une seconde partie du livre, intitulée aussi sobrement que la première (Paris-Mayotte-Paris), avec deux fois le nom de l’île inscrit à l’inverse du premier récit (Mayotte-Paris-Mayotte), elle tente une entrée. Son appréhension se déplace. « Je lis, ou relis, quelques textes de cliniciens voyageurs, les prédécesseurs qui ont déplacé les coordonnées de l’élaboration clinique »[9]. Doutes, inquiétudes, questionnements. Son séjour dans l’île la travaille. Elle parle d’apprentissage. « Mayotte n’est plus pour moi seulement le nom d’une île, mais d’une façon de pratiquer qui infuse dans mes lieux habituels. Ce séjour m’a exercé à moduler, à réinventer le rapport au cadre clinique autour de ses points d’articulation élémentaires ». La sagesse du cru enseigne que le voyage, toujours, apporte satisfaction : « Kapvwana msafara wa bure ». Elle quantifie les enjeux d’une terre, ainsi que l’absurdité qui les accompagne. Nous sommes en 2007. Elle fait le constat de la migration criminalisée en provenance des autres îles, bien qu’elle ne le présente pas toujours sous cet angle.
« Environ dix mille reconduites à la frontière chaque année, soit près de la moitié des reconduites totales prononcées en métropole, pour une population trois cent cinquante fois moins nombreuse. Et le taux est voué à s’accroître chaque année. Il est vrai les Comores font un bon vivier de chiffres, puisque les « baladés » reviennent. Que tout le circuit des traversées, des reconduites et des comptages recommence »[10]. Elle invoque Saïndoune Ben Ali : « Et l’anonyme mort grandit… ». Elle réfléchit beaucoup autour de cette population brinquebalée, s’émerveille de cette psychiatrie en train de se renouveler en pratique, bien qu’avec une équipe qui ne passe jamais les limites du cadre établi par l’institution. Janody évoque l’opacité dans lequel s’instruit leur travail, « là où s’entrecroisent la réception des symptômes, les impasses d’une politique postcoloniale et les insus des cliniciens »[11]. La description du tabouret inconfortable ramène à la ligne de partage : une frontière habile entre le territoire de Mayotte et l’Etat des Comores.

Sur les murs à Mamoudzou.
A Mayotte, la mémoire blessée tranche avec un réel désastreux. Imaginaire déconstruit, au détriment de ce qui fait archipel. Les « Mahorais » « se départissent autant que possible de la dénomination « Comores », qu’ils « réservent aux seuls ressortissants de l’Etat des Comores »[12]. Ils vont jusqu’à broyer les identités, intégrant la notion de clandestinité, empruntée pour nommer le cousin ou le voisin de l’île d’à côté. La souffrance enracinée dans le démembrement. La réécriture de l’histoire redessine les contours de ces îles. La manipulation des faits nourrit le déni grandissant. Le mouvement participe d’un délitement plus grand, où les patients sont pris en étau dans « cette pince infernale », qui ne figure en réalité que l’épisode néocolonial d’une mémoire elle-même prise en otage. La folie affleure à cet endroit où l’habitant dépossédé de sa réalité se voit investi d’une autre charge, qui concourt chaque jour à déshumaniser les uns et les autres dans une spirale qui n’en finit pas. La clinicienne s’en inquiète : « Je suis seulement de passage mais j’ai envie de crier devant ces absurdités. Quelle forme de vie s’agit-il donc d’éteindre. Et au profit de quelle instance. De quelle folie des frontières ? »[13]
L’unité d’hospitalisation psychiatrique se vit elle-même tel un symptôme. « Des fous, je n’ai pas manqué d’en rencontrer en territoire mahorais, en recevant ou rendant visite à des patients dont les symptômes explosifs et durables vont de pair avec une déstructuration des liens. Ils délirent, c’est-à-dire qu’ils sont sortis du sillon commun, selon l’étymologie généralement acceptée de dé-lirer. Et le fait est que ces occasions de bascule délirante ne cessent de se multiplier, comme dans toute société secouée par de violentes mutations ». Appelée initialement Maore – encore une histoire de nomination, générée par le regard de l’autre – Mayotte devenue française, se mue en laboratoire où le projet colonial, se poursuivant, entraîne la population vers des pathologies, qui ne relèvent pas de la folie telle que l’enseigne le monde occidental. La clinicienne s’interroge. A vouloir psychiatriser, ne risque-t-on pas « de fixer en psychose des histoires de folie discontinues qui résistent, à leur manière, aux acculturations brutales ? La dérive est prévisible, et je ne tiens pas à être mêlée à ce genre d’opérations. Sauf que c’est trop tard. J’y suis déjà mêlée » ?[14]
Le livre se poursuit sur une lecture de cas. On sent un relatif intérêt de la part de Patricia Janody, envers ce nouveau territoire de complexités. Elle s’arrête sur le cas de Malick Salim Abdallah, qui est suspecté de folie, mais n’en est pas un : « Il a sans doute de bonne raisons d’être énervé »[15], s’entend-elle dire. A commencer par le sentiment d’être victime d’un vol, qui s’avère être une dépossession de soi, en réalité. « Nombreux sont ceux, né Mahorais ou désignés clandestins, qui n’ont plus d’autre que des symptômes psychiatriques pour avaliser leur existence »[16]. Décalage, déphasage, aliénation culturelle. Mayotte française est synonyme de déconnexion avec un ensemble historique déconstruit : la poursuite d’une tragédie qui ne dit pas son nom. L’odeur de Mayotte, une clinique des frontières chemine sur ces sentes. Un récit fait de questionnements, les uns à la suite des autres. Une clinicienne partie de Paris se demande ce qu’elle fait en ces lieux ? La réalité lui répond, en exigeant qu’elle embrasse les contours d’un archipel, pour mieux saisir le pays qui se dérobe sous ses yeux. Aux traumas tus dans une société en pleine recomposition depuis quasiment dix siècles – où l’opacité fait cercle – s’ajoute le fardeau colonial récent, qui perturbe le jeu, au point de voir se démultiplier les processus de dépossession. Ceci n’est peut-être pas écrit comme tel dans le livre, mais se lit dans le creux des constats énoncés.
Med
[1] Editions Epel.
[2] P.43.
[3] P.46.
[4] Idem.
[5] P.51.
[6] Idem.
[7] P.52.
[8] P.53.
[9] P.65.
[10] Idem.
[11] P.73.
[12] P.73-74.
[13] P.83.
[14] P.98.
[15] P.99.
[16] P.109.